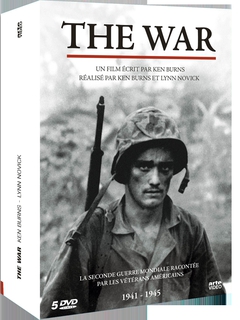« The War », un documentaire de Ken Burns

Sommaire
« … le plus grand cataclysme de l’histoire commença avec des émotions simples et ordinaires : la colère, l’arrogance, le goût du pouvoir, le fanatisme et le sectarisme. Et il prit fin parce que d’autres émotions entrèrent en jeu : le courage, la foi, la soif de liberté… — »
Transitivité humaine

Cette vision de la Deuxième Guerre mondiale, à la fois trop simple et humainement juste, est celle d’un cinéaste que l’Europe découvre depuis une quinzaine d'années à peine (The War a été primé à Cannes en 2007), auteur d’une œuvre certes ancrée dans le fonds historique américain, mais qui, dès la première image, dès le premier mot, se positionne au-delà de son sujet et tout à la fois, sans contradiction, en plein cœur. D’une poésie sociale proche d’un Jean Vigo ou d’un Louis Malle, son travail puise autant aux sources du documentaire qu’à celles d’une cinéphilie nourrie de films épiques (John Ford, Henry King) et de maîtrise formelle (Hitchcock). Son œuvre rassemble deux qualités rarement réunies : souplesse et maîtrise. Au départ, nulle préméditation. Une vocation de cinéaste l’oriente modestement vers des écoles de province. Son attention mûrit au hasard des rencontres, au contact de professeurs, qui, maîtres spirituels, lui révèlent la beauté, la richesse dramatique du réel, et le détournent peu à peu de la fiction. Une noble initiation : un homme, que sa sensibilité dispose naturellement à la rêverie, revient au monde par le même chemin, par cette même qualité, cette fois-ci les yeux ouverts. Pour autant, il ne renonce ni au récit ni à la poésie. Ses sujets sont variés : sport, jazz, politique ; un splendide opus sur la guerre de Sécession, un autre sur le base-ball. The War est sa première édition européenne. Au-delà de cette apparente diversité, Ken Burns n’hésite pas à déclarer qu’il fait toujours le même film.
Les photographies, les témoins, les archives : nul besoin de forcer, d’en rajouter. L’engagement de Ken Burns se manifeste dans le choix de ceux qui prennent la parole, celui des photos, dans le montage – une façon personnelle, intime, d’aborder l’histoire.
« (…) mon travail (…) est celui d’un mécanicien qui cherche à comprendre comment fonctionne la machine de son pays en abordant souvent le problème racial. — ».
The Civil War, Unforgivable blackness, Jazz… Autant de titres qui abordent frontalement la question raciale. Mais The War n’est pas en reste. La parole donnée aux diverses communautés ethniques et les incessants va-et-vient entre le front et l’arrière du combat, dénoncent une des plus graves contradictions des États-Unis à ce moment décisif de l’Histoire : un pays raciste combat un autre pays raciste. Non mixité raciale des bataillons, émeutes et lynchages dans les usines où, état d’urgence oblige, les Afro-Américains sont promus au rang de manœuvres, ségrégation omniprésente – auxquels il faut rajouter, après Pearl Harbor, la mise en quarantaine des citoyens américains d’origine japonaise.

La guerre vue par les Américains ?
L’idée d’un documentaire fleuve sur la Deuxième Guerre mondiale a déjà donné lieu, en France, à une captivante série télévisée, entre 1989 et 2001, Histoire parallèle. Si le principe de l’émission de l’historien Marc Ferro consistait à confronter les actualités d’époque des différents pays en jeu pour en débattre ensuite avec des spécialistes, le propos de Ken Burns se situe ailleurs, même s’il insiste souvent sur la disparité entre la (dés)information et la réalité du terrain. The War ne cherche pas à comparer les points de vue. Il est vrai que le documentaire se déploie à partir de quatre petites villes américaines : Mobile, Waterbury, Sacramento et Luverne. Là-bas, comme partout ailleurs, des jeunes Américains se sont portés volontaires. Certains ont survécu, d’autres sont morts. Ils apparaissent, au fil des épisodes, de plus en plus familiers, de plus en plus proches. L’emploi de la musique accentue le processus de familiarisation. Tout au long du documentaire, les mêmes airs (jazz, classique, vif, triste) sont utilisés comme des leitmotive associés à certaines scènes, endroits, personnages. Les quatre villes ont été choisies pour leur neutralité mémorielle.
La durée du documentaire – quatorze épisodes, douze heures – restitue une dimension essentielle de la guerre : une durée qui semble infinie. Comment se figurer l’ampleur de ces années dans le cours d’une vie ? En suivant, jour après jour, ces hommes et ces femmes. L’esprit commence peu à peu à se représenter leur quotidien ; les visages se précisent et, construite par l’alternance entre photos d’époque et témoignages actuels, une personne réelle se matérialise peu à peu, plus qu’un instantané étranger, trop vite oublié, un être dans la durée. Les souvenirs racontés côtoient une narration à la troisième personne, les archives sont augmentées de plans actuels, et cette juxtaposition des deux époques provoque un phénomène étrange : l’annulation du temps. On sent la durée de la guerre, mais il devient difficile d’imaginer qu’elle appartient au passé. Si touchants sont les témoins que leur récit envahit le présent, comme s’ils nous entraînaient au centre de leur mémoire.
The War, malgré une solide documentation, ne prétend pas à l’approche épistémologique d’Histoire parallèle, pas plus, finalement, qu’il ne nous donne sur la guerre un point de vue spécifiquement américain, les États-Unis faisant tout au plus office de point de départ. Aussi, les critiques soulevées par tel ou tel groupe d’influence, la colère de la communauté latino-américaine de ne pas avoir été représentée, les lacunes évidentes du récit (nulle mention de l’action de la Résistance…) peuvent-elles être nuancées. Le sens de ce documentaire, s’il faut comparer, se rapproche davantage du magnifique Thin Red Line, de Terrence Malick ou du diptyque de Clint Eastwood : Flags of Our Fathers / Letters from Iwo Jima. Ces trois films ont en commun la guerre du Pacifique (les batailles de Guadalcanal et d’Iwo Jima). La fiction donne a priori une liberté plus grande dans le traitement thématique que dans celui du documentaire. Terrence Malick plonge les soldats américains dans un chaos où végétal, minéral et animal se répondent ; la destruction se propage comme un écho qui engouffre un monde incompréhensible et exsangue. Clint Eastwood tourne deux films différents, pour illustrer tour à tour le point de vue américain puis celui des Japonais, mais au final filme encore autre chose. C’est aussi l’esprit du splendide film russe Requiem pour un massacre qui approfondit également un épisode de cette guerre tentaculaire. Dans chacun de ces films comme dans The War, la guerre parle avant tout de l’humain. La mise en situation contextuelle n’est pas un dispositif de rigueur historique mais au contraire un resserrement sur l’individu. Déjà dans Guerre et Paix, Tolstoï utilisait ce procédé, un aller-retour continuel du particulier au général, des micro-récits imbriqués dans l’Histoire, sans hiérarchisation. La guerre figure cet état extrême de l’humanité où tout est exacerbé ; elle met en évidence tout ce qu’un quotidien rassurant, routinier, étouffe. Folie ? Absurdité ? Non. Un quotidien révulsé, sans faux-semblants, ses grandeurs, ses misères, ses injustices, ses joies inespérées.

Le Ken Burns effect
La matière première de Ken Burns est la photographie. En tant que documentariste, il a mis au point une approche originale qui porte désormais son nom : le Ken Burns effect . Ce procédé consiste à filmer les photographies comme des scènes vivantes, réelles – plan éloigné / plan moyen / plan rapproché. Le résultat ne manque pas de surprendre. Il résout deux problèmes majeurs dans l’utilisation des photographies. Premièrement, la question morale inhérente au sentiment esthétique qu’elles suscitent (voir aussi, à ce propos, Le Ghetto de Varsovie). Peut-on admirer une image pour sa beauté lorsqu’elle capte un moment de souffrance ? Comment se défaire de cette attirance, de cette fascination ? La caméra qui plonge au cœur de la photographie et la révèle progressivement à l’œil, lui restitue une dimension morale. Le mouvement déplace le regard ; la photographie peut parler, raconter, faire exister. Non plus contemplation muette et coupable de l’horreur, mais participation, écoute.

Le second problème qui, contrairement à celui que je viens d’évoquer, préoccupe aussi les producteurs de Ken Burns, découle de l’ennui présumé d’un documentaire-diaporama. Une séance photos n’a qu’un intérêt limité ; une heure, peut-être, mais douze heures ! Le Ken Burns effect, en exagérant à peine, transforme l’exposé en thriller. Sans s’attarder sur la profonde parenté de ce procédé avec l’invention de Chris Marker dans La Jetée, c’est ici que l’on décèle l’influence de Hitchcock sur le style de Ken Burns. Il agit comme un second révélateur. La photographie devient un tableau rempli de mystère, une scène inquiétante dont la signification réelle n’apparaît qu’au dernier plan. La caméra part d’un gros plan sur un visage creusé, les yeux exorbités levés vers le ciel. Doucement, elle descend, part un peu à droite, c’est une plage, le sable, plus loin les flots, des hommes, assis par terre, accablés, la caméra descend encore, et c’est le dernier plan : dans les bras de l’homme, un corps, ensanglanté, mort. Un suspense essentiel, qui anime les documents. Les hommes agonisent en temps réel, ils pleurent encore et toujours, ils sont sales, exténués, mais aussi fiers, courageux, aimants. On sent la force de la camaraderie, le meilleur et le pire de la nature humaine. Il est essentiel qu’un documentaire puisse, aujourd’hui plus que jamais, sans rien ajouter, à partir de documents historiques, raviver aussi intensément notre mémoire. La caméra-œil, dans la lenteur de sa trajectoire, accuse l’insuffisance du regard. Le détail peut contredire la scène, un morceau de photographie dire le contraire de sa totalité.

Neverending story
The War, c’est douze heures de violence. Un documentaire éprouvant dans la longueur, comme dans chaque détail. Malgré l’abondance des éclats de lumière, la musique, souvent entraînante, les nombreux sourires (tous ces soldats qui posent devant l’objectif sont radieux…), malgré l’absence de pathos, parcourir la mémoire de cette guerre reste une expérience difficile. Certaines images, alors que l’écran est encore noir, sont devancées par des bruits de tirs, d’explosion. Pendant quelques secondes on se prépare, on imagine la scène. Mais la grande force de Ken Burns, c’est de toujours surprendre le spectateur. Ces archives, peut-être ont-elles déjà été diffusées mille fois. Il nous les dévoile autrement – ou bien, pour être exact, il les montre vraiment. L’avant-dernier épisode expose la découverte des camps de concentration. Scènes terribles, images insoutenables, doublées du visage d’un témoin qui, aujourd’hui encore, baisse la tête et cache ses larmes en évoquant ce souvenir. Ensuite, il ajoute, de façon inattendue, que c’est à cet instant seulement qu’il a compris que le combat avait été juste.
Le documentaire n’élude pas la question de la bombe atomique. Les témoins interrogés, en soulignant la part de soulagement personnel de leur réponse, ne peuvent que l’approuver. D’un côté l’Allemagne vaincue, de l’autre la pérennisation du combat contre les Japonais, prêts à résister jusqu’au dernier homme. Le contrepoint est avancé par un combattant juif-américain, incrédule devant la mort de tant de civils. Son trouble referme le documentaire sur un sentiment d’impuissance, une amertume devant l’irréparable. On en restera là, face à cette juxtaposition de foyers destructeurs : le front, les camps de la mort, Hiroshima et Nagasaki. Le miracle opéré par le travail de Ken Burns est d’intensifier l’attention du spectateur et, paradoxalement, à partir d’instantanés, indiquer que rien ne finit jamais.
Catherine De Poortere