La rivière m’a dit

Le Frac Île de France est transformé en une ruche de salles obscures. On circule dans la pénombre, d’écran en écran. Dans cette caverne, les films projetés sur les parois font figure d’art pariétal du futur. Ils racontent pour les générations futures le basculement de nos relations à la nature. Il faut se poser, il y a quelques coussins à terre (la projection cinématographique en galerie ou musée est rarement confortable). Chaque film, s’agissant de ce que l’on appelle « film d’artiste », active un principe narratif singulier. Rien à voir avec le cinéma industriel dont les scénarios se ressemblent tous, exploitant les mêmes recettes à audience et les présentant comme des schémas universels. On progresse lentement dans le dédale et de salle en salle, on glane quelques impressions fortes qui construisent à leur tour le petit film intérieur que l’on conservera de cette immersion dans La rivière m’a dit. Aucun film n’est numérique, il s’agit de pellicule bien matérielle, de relation charnelle à la fabrication d’images vivantes.


Face au premier écran, Why Are You Angry ? de Nashashibi/Skaer, je retiens l’impression de temporalités conflictuelles, peut-être dues à l’alternance entre scènes en noir et blanc, d’autres en couleurs. Les fleurs dans la chevelures d’une femmes au volant rappellent tout l’imaginaire paradisiaque des îles lointaines, mais enfermé dans l’automobile, vecteur de l’enfer sur terre. Nous sommes bien à Tahiti qui fut longtemps symbole du paradis sur terre, où beaucoup y allèrent pour retrouver la nature la plus vierge et sauvage possible. Le paradis est, aujourd’hui, plongé dans une puissante atmosphère de langueur, proie d’un étrange magnétisme fataliste. Feuillage tropical agité, bungalow coloniaux quelconque. Les corps sont en suspens, en attente, privés de. Sur des lits, des sofas, des jeunes filles nues dans des poses qui font penser à. Elles ne sont pas là simplement nues, elles posent. Ambiance de ces matinées chaudes, lumineuses où l’on se contente de deviner ce qui se passe autour, d’interpréter bruits, lumières et ombres venant du dehors. Oui, ces tableaux ressemblent à des choses déjà vues. De même que le groupe de femmes presque en léthargie devant les maisons. En jetant un coup d’œil au guide du visiteur, on trouve la clé du mystère : ce sont des évocations de toiles de Gauguin. Il reste que la proximité visuelle avec la nudité de ces jeunes corps – qui étaient aussi la nature vierge et sauvage convoitée par les occidentaux - , comme exposée contre l’omniprésence sourde de la nature, toile de fond végétale immédiate, tout contre les bungalows, rideau de palmiers hirsutes, crée une drôle d’impression de drame statistique. Quoique l’on fasse, ça arrive, ça vient. Ces organismes humains font partie de la nature et en sont pourtant irrémédiablement séparés, d’une autre nature, il n’y a plus de connivence. Peinture après peinture, il y a eu séparation, éloignement. Quelque chose menace. Même le paradis est soumis à la loi de l’anthropocène, il n’y a plus de lieu où s’échapper. Le paradis est perdu.

À chaque visiteur son cheminement, en ce qui me concerne, je me retrouve ensuite devant Origin of the Species de Ben Rivers. Un travailleur forestier s’est installé dans la nature, perdu dans la forêt. Petite cabane en planche, fumée blanche abondante. Il ressasse les grandes questions sur l’origine des espèces. Citation de philosophe, références à la physique quantique confrontées aux expériences concrètes de ce que l’on voit et sent au contact direct. Ses méditations poétiques et scientifiques, politiques aussi, sont cesse enrichies par ce qu’il voit et touche, disons au ras du sol. Il est ainsi entouré de formes sommaires de vie, végétales, animales, minérales, vestiges immémoriaux de la vie avant les humains, c’est comme s’il vivait en compagnie de manifestations naturelles qui lui racontent sans cesse les débuts, les balbutiements, les errements. C’est toujours en train de se passer. En même temps, son cerveau ressasse des bouts de théorie pointues, modernes. Toutes les étapes coexistent et interagissent encore et toujours entre elles. Il en fait l’expérience en menant une existence dans un décor sauvage, éprouvant dans ses gestes, ses travaux, et rudes bricolages la difficulté de se garder une place au sein d’une nature qui le dépasse, le submerge. En un seul être cohabitent des étapes différentes de l’évolution, l’harmonie et la rupture avec les éléments naturels, la compréhension et la perte de repères, la science et le mystère. Le message est que l’équilibre à trouver est fragile, délicat, nécessitant pas mal d’humilité, vertu d’ermite du genre de celui qui parle et agit dans ce film.


La vidéo de Mélanie Bonajo, avec Night Soil#3/Nocturnal Gardening, raconte quatre destins de femmes qui retissent des liens utile s, individuellement et collectivement, avec l’environnement naturel. Le film d’artiste rejoint le cinéma militant. La première que l’on suit se promène en forêt avec sa fille, raconte comment avec son mari ils se nourrissent de tout ce qu’ils trouvent, tubercules, herbes, fleurs, fruits, animaux écrasés (ils ne tuent plus pour se procurer des protéines animales). La récolte itinérante de fleurs, de graines, de fruits, de champignons active un répertoire impressionnant de connaissances sur les vertus nutritives de ces ressources naturelles. C’est un travail. Mais qui s’agrémente aussi de jeux et de détentes avec les éléments, la rivière, une cascade, un lit de mousse, un tronc d’arbre accueillant.
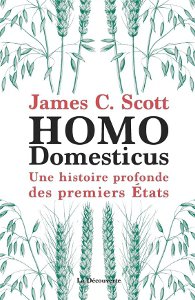
Cette célébration de l’époque des chasseurs-cueilleurs rejoint la critique du « récit civilisationnel standard » critiqué par certains anthropologues dont James C. Scott qui vient de publier « Homo domesticus. Une histoire profonde des premiers Etats. » Ce récit civilisationnel dominant décrète qu’à partir d’une date « magique », la domestication des graines de céréales a permis l’apparition de l’agriculture structurée et l’émergence d’États plus protecteurs. Et tout ce qui a précédé relève de la barbarie. Selon, James C. Scott, les barbares avaient une belle vie, ils exerçaient des savoirs et des savoir-faire variés et élaborés, ils « administraient » les ressources naturelles diversifiées avec prévoyance, ils pourvoyaient à leurs besoins en travaillant pas plus de quatre à cinq heures par jour. Il s’inscrit en faux contre ce principe narratif où tout doit commencer à des moments précis. L’homme a planté et semé, s’est livré à une agriculture sauvage et une horticulture légère bien avant l’ère de l’agriculture. La prédominance des céréales a aussi permis d’organiser la taxation, le contrôle. Le principe de chasse et cueillette reposait sur une gestion collective des biens naturels, sur le principe des communs, sans présence d’un pouvoir central. Peut-être faut-il dater l’anthropocène des débuts de l’agriculture qui s’est imposée peu à peu, affrontant de nombreuses résistances. « Dans la mesure où l’agriculture tendait à restreindre la mobilité potentielle de chasseurs-cueilleurs sédentaires, leur incapacité à réagir de façon suffisamment rapide, par exemple, à une migration précoce d’oiseaux ou de poissons aurait affaibli, plutôt que renforcé, leur sécurité alimentaire. Il existe de nombreux indices de l’abandon fréquent, tout au long de cette période, de sites sédentaires au profit d’un mode de vie pastoral ou de cueillette itinérante, ce qui montre bien que la sédentarité n’était qu’une stratégie parmi d’autres et non pas l’idéologie qu’elle deviendra plus tard. » (p.79) Le film, tout en images poétiques, et commentaires lucides, politiques, raconte tout ça, revient et fausse compagnie au « récit civilisationnel standard » !

Charlotte Cherici avec Pourquoi tordu ? scrute la frontière trouble entre ici et l’au-delà, entre vie humaine et ce que l’homme a toujours pressenti (ou voulu pressentir) comme étant derrière la nature. Outre. La relation au religieux. Elle nous plonge d’abord dans un cortège populaire, folklorique et carnavalesque, une cérémonie de crucifixion dans une ville d’Amérique latine. La croix, le corps du Christ, l’armée. Le côté un peu brut et amateur confère une signification confuse à cette Passion. Ensuite, elle nous place au plus près d’un homme, un « tabaquero » qui pratique des fumigations purificatrices. Purifier quoi ? La caméra qui est en train de prendre en images. Dans une société où se produisent des rituels de guérison, il est « fatal » que les enfants jouent à imiter ces cérémonies. On voit ainsi un groupe d’enfants rassemblés dans les prairies imitant la mise en scène, les rôles, les attitudes, les postures, les formules. Simple jeu ou apprentissage ? Un shaman fredonne, chante, met en rengaine des bribes de cheminements magiques. Par où sortir ? Par où recommencer une autre relation au vivant ? Il y a quelques plans nocturnes impressionnants, dépaysants, sublimes.
« Il faut savoir que nous sommes dans cette région où s’est passée l’histoire de Fitzcarraldo que Werner Herzog a portée au cinéma… C’est vraiment un pays de toutes les folies. Il y a aussi ces plans quelque peu effrayants où l’on perçoit les visage du shaman par le seul reflet de la lumière de la caméra. » (Xavier Franceschi, commissaire, guide du visiteur)

Bird de Margaret Salmon commence par un touchant catalogue d’oiseaux. L’un après l’autre, fragile et irréductible, entité radicalement sauvage, pris dans la main d’un enfant qui épelle son nom. Puis la caméra s’égare dans les arbres, les ramures, les feuillages, la mosaïque de lumière et de feuilles. Tandis que monte le chœur de chants d’oiseaux invisibles. De plus en plus fort. Pas le chant conjugué de telle ou telle espèce, non, la clameur de tous les oiseaux invisibilisés. Clameur d’une disparition, d’une extinction des espèces.

Ben Russell nous offre, avec River Rites, une seule prise de onze minutes sur un fleuve sacré du Haut Suriname. Quels rites ? Ce que l’on voit sont des activités immémoriales entre fleuves et humains : pêcher, naviguer, laver la vaisselle ou le linge, se baigner et, pour les enfants, jouer. C’est-à-dire manier, malaxer le sable des berges, avec les mains, avec les pieds, projeter des gerbes d’eau en frappant la surface de l’eau avec la paume, s’éclabousser mutuellement, plonger, rester le plus longtemps immergé… N’importe quel gosse au bord de l’eau ou sur une plage pratiquera tout ou partie de ce répertoire, avec des variantes. Les gestes, en surface, semblent aller à sens unique, de l’homme vers le fleuve. L’homme tire parti de l’eau qui coule. Sauf qu’ici, le cours de l’image est bizarre. Ce que l’on observe est à la fois banal et anormal. C’est que l’image défile à l’envers. (Tout le temps ou à certains moments ? Il faut un certain temps pour s’adapter, saisir ce qui se passe.) Ce qui donne alors l’impression que l’énergie dépensée par ces corps pour profiter du cours fluvial, énergie individuelle, est bien plutôt manifestation de la puissance d’être que le fleuve insuffle aux humains qui communient avec ses eaux. On est à la source de l’animisme.
Pour avoir une bonne perception de cet ensemble de six films projetés de manière rapprochée, croisée, en un seul lieu, chacun dans une niche ou alcôve aménagée dans l’espace du Frac, il faut consacrer deux bonnes heures. Après, on va revoir, tel ou tel extrait, on circule de façon plus désordonnée. L’intention n’est pas de réunir des films qui alarment sur la situation ou qui fournissent de nouveaux arguments pour convaincre de la dimension critique de la situation. Le fait de l’effondrement est acquis. Comme dit le commissaire, ce sont avant tout des films d’artistes. Ils documentent plutôt par le biais de l’expérience esthétique, chacun avec leur poésie singulière. Ils font éprouver la richesse complexe de nos relations avec la biosphère, selon des focales rapprochées ou larges. Une riche complexité en voie de disparition. On mesure – mais avec les sens, les émotions grâce à des langages imagés, des récits atypiques – toute l’étendue de la perte en train de se produire, tout ce qui dans notre intime risque d’être coupé de ce qui nous nourrit.
Pierre Hemptinne
photo du bandeau : Night Soil #3 / Nocturnal Gardening - (c) Melanie Bonajo, 2016
Collection frac île-de-france
exposition collective La Rivière m'a dit
comissaire : Xavier Franceschi
Jusqu'au Dimanche 14 avril 2019
Frac Île-de-France
Le Plateau, Paris
22 rue des Alouettes
75019 Paris
France