« Rond est le monde » (Olivier Dekegel) : film-monde à l’échelle des pas d’un homme

Par où commencer ? Par où aborder Rond est le monde (2013) d’Olivier Dekegel ? Par son début, comme neuf fois sur dix quand on raconte un film par son pitch ou son intrigue ? L’ouverture du film est certes très belle – un crescendo ; la levée du souffle du vent puis la fonte de la neige et un petit filet d’eau devenant un impétueux torrent de montagne souligné par les diagonales tourbillonnantes d’un montage dynamique –, mais on sent qu’il serait un peu arbitraire de se focaliser sur ce moment.
Comme le lombric filmé à la onzième minute, dont le corps en anneaux se referme sur lui-même pour former presque un O, comme l’Ouroboros de la mythologie, comme la ronde des saisons et les autres cycles de la vie, Rond est le monde peut être vu comme un film circulaire. — Philippe Delvosalle
À l’image des couronnes de fleurs de la Saint-Jean ou de l’enchevêtrement de brindilles des nids d’oiseaux, Olivier Dekegel entrelace de nombreux fils (la relation de l’homme au monde animal, leur inscription dans les paysages ; les rencontres fortuites mais jamais bradées ; les phases de la lune ; le pacte d’amour qui se noue entre la pellicule, les couleurs de la nature et la lumière) qui apparaissent et disparaissent et qui, surtout, ne semblent pas devoir s’arrêter au générique de fin et pourraient continuer à aller et venir au-delà des quarante minutes du film.
Parce que, au-delà de la modestie de son auteur, sorte de franciscain païen du cinéma, et de la simplicité de son dispositif – « en compagnie d’un âne et d’une caméra super 8, un cinéaste traverse le monde et s’enivre de la beauté de toutes choses », – ce film est un monde. Mais un monde à l’échelle d’un homme, du cinéaste – de ses mains, de ses pas et de ses sens.
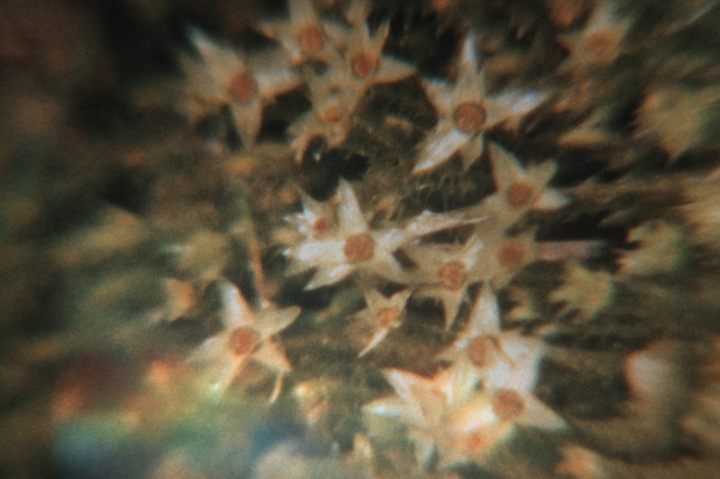

Rond est le monde est un film de marche, il ne pourrait exister sans elle, il en porte à la fois le rythme, la lenteur et la richesse, la place laissée au vagabondage de la pensée mais aussi l’ancrage bien physique et concret à la terre et au paysage. Le pied du cinéaste – le sabot de l’âne – échange des informations avec le sol, avec la roche et les cailloux, avec les touffes de graminées des prairies, avec la boue des sentiers détrempés, etc. — P. D.
Le pas mesure l’espace et rythme l’écoulement du temps. Rond est le monde est un film expérimental non pas parce qu’il respecterait les codes d’une éthique et d’une démarche de cinéma en partie figée en tant que genre (« le » cinéma expérimental) mais parce qu’il propose le passage, par le truchement des images (muettes à l’origine) et du son (construit après coup), d’une série d’expériences sensorielles du cinéaste au spectateur.
Dans sa vie quotidienne (dans les taxis ou les bars de quartier par exemple) ou dans son précédent film Gnawa (prix Henri Storck 2011), Olivier Dekegel semble mu par une inclination naturelle à aller vers l’autre. Le mouvement et la dynamique de Rond est le monde paraissent différents. Un recul temporaire par rapport à la société des hommes et une certaine solitude sont parties intrinsèques du projet. Mais la solitude n’est qu’apparente et est vite dépassée par la relation qui se noue avec « le plus simple, le plus humble de tous les animaux ». Devant nos yeux, le duo devient presque un couple et quand, vers le milieu du film, le cinéaste zoome pour passer d’une sorte de plan américain de l’âne à un gros plan de son œil, les rôles et les statuts semblent se rééquilibrer autour de la question « Qui regarde qui ? » Puis, en plus de la dizaine de portraits – muets, frontaux, face à la caméra fixe – de bergers, de paysans et d’autres personnes rencontrées le long de ces chemins de traverse, il y a ces sortes d’autoportraits morcelés (le torse, le haut des jambes, jamais le visage) où le cinéaste lance la caméra en mode automatique et passe devant l’objectif, dans le cadre, seul ou avec son compagnon de route. Ou, comme dans la longue et belle séquence finale, s’éloigne vers l’horizon dans une neige qui lui arrive aux mollets…
Philippe Delvosalle
texte écrit à l'origine pour la revue Lectures.Cultures n°2, mars-avril 2017
