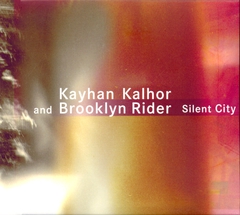SILENT CITY
Cet album est une histoire de rencontres, histoire comme on dirait affaire, mais aussi comme synonyme de récit.
Bien sûr, et avant tout, il s’agit de rencontres entre des personnes.
D’une part entre les musiciens du Brooklyn Rider à partir de ce besoin ressenti de créer un quatuor à cordes en accord, en phase, avec son temps et son public.
D’autre part, et sans aucun rapport chronologique – cette étape ne vient pas après l’autre - la rencontre avec Kayhan Kalhor. L’occasion de cette rencontre est emblématique: elle a eu lieu dans le cadre du projet « La route de la soie » (« Silk Road Journeys ») initié par le violoncelliste Yo-Yo Ma. Cette fameuse route allait donc encore réunir des cultures et des traditions, provoquer des interactions, initier de nouvelles formes musicales des siècles après.
C’est aussi l’aventure d’une rencontre d’instruments. Et celle-ci fut facile, naturelle: le kamanche (instrument à cordes frottées muni d’une caisse de résonance sphérique que l’on retrouve en Iran, en Turquie, au Kurdistan, en Afrique méditerranéenne, en Arménie, en Géorgie…) de Kayhan Kalhor, les violons, l’alto et le violoncelle des musiciens de Brooklyn Rider, tous des instruments à archet ayant des ancêtres communs.
Inévitable, c’est aussi une rencontre de traditions - européennes, iraniennes - de genres musicaux, la musique classique contemporaine (européenne s’il est besoin de le préciser) et la musique classique persane surtout. Toutes deux ont une histoire qui remonte les siècles et relève de l’écrit. Mais autant la musique classique dans ces dernières évolutions a pris nettement ses distances d’avec la religion, autant la musique persane reprend toujours le leitmotiv de la transcendance et de l’amour du divin, leitmotiv que l’on retrouve dans la majorité des musiques sacrées de la région.
Toutes ces rencontres sont à l’origine d’un album à écouter et à vivre comme un voyage : d’un mythe populaire où un oiseau cherche à atteindre le soleil au vers du poète turcophone Fuzûli: « Bien-aimé, ne me laisse pas me décourager », c’est à un périple circulaire que nous sommes conviés.
Comme un vol au cours duquel défilent sous nos yeux traditions séculaires et légendes persanes, villes détruites et civilisations déchues, personnages de légende, airs persans traditionnels et compositions actuelles, un vol circulaire parce que la fin advient au même endroit que le commencement, mais avec un point de vue différent.
La première plage « Ascending Bird » s’inspire de ce mythe d’un oiseau cherchant à rejoindre le soleil. L’histoire raconte qu’à la troisième tentative, il se consume dans l’étreinte brûlante de l’étoile. Comment ne pas saisir d’emblée l’analogie avec notre mythe antique d’Icare? Mais même si le projet est semblable, la chute - c’est le cas de le dire - et la conclusion à tirer sont bien différentes. La chute d’Icare symbolise la démesure, la témérité et la vanité de l’homme. La disparition de l’oiseau au sein du soleil symbolise la transcendance spirituelle, un thème récurrent de la tradition musicale persane.
Sur base d’une combinaison entre un air traditionnel de la région de Khorasan, à l’est de l’Iran, et une introduction originale, le morceau nous entraîne dans une mélodie aiguë jouée sur un rythme échevelé au tombak (tambour iranien en forme de gobelet) et au cajon (percussion en forme de caisse, dont la paroi vibrante est frappée à mains nues par le musicien assis sur la caisse).
La musique défile à une vitesse folle et s’achève soudainement sur une succession vertigineuse de notes montantes, figurant la dernière tentative où l’escalade folle de l’oiseau l’amène à se fondre dans le soleil.
Sans hésitation, le moment fort de ce fabuleux voyage est la deuxième plage : « Silent City ». Elle est fort différente des autres par sa longueur (presque 30 minutes), par sa source d’inspiration et par son procédé puisque la première longue partie est totalement improvisée.
Inspirés de la destruction de la ville d’Hallabjah dans le Kurdistan iranien, Kayhan Kalhor & Brooklyn Rider rendent témoignage pour les villes dévastées et les civilisations disparues.
Le début est pratiquement imperceptible, brouhaha murmuré, bourdon de cordes, décrivant un monde dépouillé totalement. On est littéralement happé par cette montée lente et quasiment infinie, cette émergence sourde à partir d’un magma de vibrations sonores, figurant un monde dévasté dont ne subsistent que des décombres froids, glacials. Désolation, désespoir et impression de vide sont prégnants. Quelle infinie tristesse les musiciens arrivent à extraire de leurs instruments! Petit à petit, le mouvement prend de l’ampleur jusqu’à un climax libérateur d’où surgit comme une renaissance, comme un espoir avec le kamanche interprétant une ancienne mélodie turque. Le tout s’enroule pour s’achever sur une danse kurde joyeuse, enthousiaste. La vie renaît de toutes les cendres…
La troisième et la quatrième plage bouclent le voyage en revenant sur les thématiques développées au cours du premier morceau.
La troisième, une composition de Kayhan Kalhor, jouée sur un setar (sorte de luth à long manche, pourvu de quatre cordes, utilisé au fil des siècles par les bardes, les conteurs et les poètes) reprend la légende de l’oiseau en accentuant l’idée de l’envol jusqu’à l’extase, jusqu’à la consomption par Dieu. L’introduction, jouée au setar, dans une débauche de notes douces et peu élevées, voit arriver les violons, alto et violoncelle du Brooklyn Rider comme en arrière-fond, jouant le thème, alors que le setar ne cesse de jouer, apparaissant et disparaissant face à la puissance supérieure des autres instruments, mais toujours présent.
Le contraste entre les instruments européens et le setar, du point de vue de l’intensité du son et du jeu, est remarquable et utilisé de manière très fine.
La quatrième plage reprend quant à elle les thèmes, omniprésents dans la musique classique persane, de l’amour transcendantal de Dieu et du désir de s’y perdre, souvent raconté dans les poèmes sous la forme de l’amour profane, courtois, mais représentant toujours au final l’amour du divin.
Le titre du morceau : « Beloved, do not let me be discouraged » (Bien-aimé, ne me laisse pas me décourager) est tiré de la version de Fuzûli de la légende de Layla et Majnum, dont les malheurs rappellent ceux de Roméo et Juliette.
Composé par Colin Jacobsen du Brooklyn Rider, le début se fait par petites touches atmosphériques, certains moments étant à peine perceptibles, prenant lentement de l’amplitude, de l’élan, s’affirmant, prenant force et vigueur progressivement.
Soudain le rythme se précise, s’accélère, s’affermit, ajoutant une tension.
Petit à petit, les percussions interviennent, mais en restant toujours à l’arrière-plan.
Cette dernière plage, magnifiquement ciselée comme les autres, boucle la boucle tout en beauté. On y retrouve les éléments qui ont fait des autres plages de petits bijoux : mouvements lents atmosphériques peu mélodiques conduisant, très progressivement et souvent imperceptiblement, vers des belles envolées, très mélodiques cette fois, reproduisant toute la chaleur et l’intensité émotionnelle des musiques classiques iraniennes.
Isabelle Delaby
D’autres rencontres séduisantes :
- Ugur ISIK : « Cello Unveils Anatolian Spirit » - MY8578
Chants de bardes d’Anatolie interprétés au violoncelle. Cet instrument qui remplace le saz, instrument traditionnel généralement utilisé pour accompagner ces chants, ajoute un son plus rempli, plus ample aux différentes pièces.
- Keyvan CHEMIRANI : "Le Rythme de la parole II" - MX1312
Une rencontre de trois pays – l’Inde du Sud, l’Iran, le Mali – avec comme thématique l’importance du rapport entre la voix et les percussions. D’un morceau à l’autre, tantôt entièrement composé, tantôt arrangé à partir de la tradition, les musiques se succèdent, se superposent, se soutiennent, s’assemblent et se dissocient, s’enchevêtrent, se confondent.
- Luzmila CARPIO : « Le Chant de la terre et des étoiles » - MG8423
Une voix de petit enfant, étonnamment cristalline, qui chante la terre, le soleil, le bruissement du vent, les oiseaux, la chaleur de l'aube… Surnommée le « rossignol de l'Altiplano », Luzmila Carpio chante en quechua -la langue de ses ancêtres- et mêle tradition et inventivité, entourée ici de musiciens européens jouant de la guitare, de la flûte, de la percussion ou même de l’orgue de cristal
- Liu Fang : « Le Son de la soie » - MV4835
Quatre instruments à cordes – pipa, guzheng, oud et kora – et un instrument à vent – bansuri – pour une rencontre qui jette des ponts entre les continents asiatique et africain.
- Driss EL MALOUMI / Ballaké SISSOKO / RAJERY : « 3MA » - MA1652
Trois instruments à cordes emblèmes d’une tradition musicale, le oud pour les musiques arabes, la kora pour la tradition des griots, la valiha instrument national malgache. Un album très spontané et vivant.
- No Blues : « Farewell Shalabiye » - MA1670 et « Ya Dunya » - MA1671
Un mélange entre la musique arabe traditionnelle, la country, le folk et le blues. Haytam Safia au oud, Ad Van Meurs à la guitare et au chant, Anne-Maarten Van Heuvelen à la contrebasse.