L'urbain et l'expérience spatiale selon Michel Lussault

- PointCulture : Quel genre de géographe êtes-vous? Qu’est-ce que la géographie, telle que vous l’entendez, apporte dans la manière d’appréhender l’espace ?
- Michel Lussault : Je pratique une géographie qui est peut-être un peu déconcertante si on se souvient uniquement de la géographie qu’on a pu apprendre à l’école. La géographie que je propose est plutôt ce que j’appellerais une anthropologie politique de la relation des individus à leur espace de vie. Ce qui m’intéresse depuis toujours est observer et essayer de comprendre le vécu spatial des individus et des sociétés. Très souvent, lorsque l’on pense à l’être humain, par exemple quand on fait de la philosophie, on réfléchit au fait que l’être humain, comme on dit souvent, est projeté dans le temps, on réfléchit sur le fait que le temps nous entoure, nous enferme, nous broie, nous tue, on réfléchit à notre mortalité, on en dérive une métaphysique. Quand on fait de la sociologie on pense l’humain essentiellement dans sa relation au groupe, aux autres humain.Mais il me semble qu’il manque une dimension à toutes ces analyses très intéressantes... Et cette dimension, c’est la dimension spatiale! — Michel Lussault
Le fait que nos existences, chacune de nos existences, l’existence de chacun d’entre nous – et ce nous c’est à la fois le nous du présent et le nous du passé et du futur – quel que soit le temps qui est le sien, est une existence profondément spatiale, dans la mesure où il n’y a pas une seconde dans notre existence où nous soyons détachés de notre relation à l’espace, où nous sommes détaché de notre habitation, de notre capacité d’habiter. Il faut entendre « habiter, habitat, habitation » en retrouvant l’origine du concept d’habitat, qui vient des sciences naturelles, au XIXème siècle. L’habitat c’était l’espace de vie d’une espèce. Espace de vie d’une espèce animale, espace de vie d’une espèce végétale, il y a l’habitat du sapin, l’habitat du chêne, du renard, de la mésange… Il y a un habitat de l’espèce humaine, de l’humain en tant qu’espèce. C’est donc l’espace de vie des êtres humains, de chaque être humain et des êtres humains en société et si on comprend bien l’habitat comme ça, on entend bien que l’habitat n’est pas simplement la résidence, pas simplement le logis, la maison, la demeure… C’est véritablement l’ensemble des espaces que moi, en tant qu’être humain, j’ai à rencontrer en tant qu’expérience, c’est l’ensemble des lieux, des connexions que cette expérience me fait éprouver. Donc, c’est un concept très ample, très important parce qu’on pourrait considérer qu’à travers cette analyse de l’habitation humaine, c’est justement cette dimension spatiale de l’existence qu’on arrive à penser. Ce qui me fait souvent dire que, finalement, la géographie, c’est la continuation de la philosophie par d’autres moyens. Le rôle de la géographie ce n’est pas de faire des cartes, de décrire et placer des phénomènes sur un planisphère. Pour moi le rôle de la géographie est de comprendre anthropologiquement ce qu’il en est de la dimension spatiale de nos existences.
- Mais tout le monde a-t-il cette conscience spatiale ? À force d’être toujours « dans l’espace », l’aperçoit-on encore vraiment ? N’est-il pas banalisé, ne perdons-nous pas la possibilité d’agir sur nos relations spatiales ? En quoi une prise de conscience de cette existence spatiale pourrait donner les clés pour transformer l’urbain, un urbain qui est perçu comme se développant vers la déshumanisation ?
- Il est vrai que nous sommes, en tant qu’être humain, très souvent conscient du temps, de la temporalité, du temps qui passe, nous en éprouvons même une inquiétude spécifique, liée à la mortalité et qui fait que le temps est très présent à notre esprit même quand on veut l’oublier. On se rappelle de l’adage de la philosophie grecque, le fait d’être mortel est quelque chose qu’on n’oublie jamais, même si on le dissimule. Le rapport que nous avons à l’espace est plus curieux parce que je crois que nous éprouvons l’espace, nous le ressentons, alors que le temps nous inquiète ; l’espace, nous l’éprouvons, parce que dès que nous nous déplaçons, nous savons ce qu’il en est d’éprouver l’espace. Vous parliez de la déshumanisation urbaine. Qu’est-ce qui revient le plus souvent quand, dans les grandes mégapoles, les gens disent que ces mégapoles deviennent de plus en plus inhumaines ? Très souvent il revient le récit d’épreuves dans les transports en commun, très souvent il en revient des descriptions de la difficulté de se déplacer, de la presse, du bruit, du coût, ou des choses qui ont rapport à la pollution, à la mauvaise qualité de l’environnement, à l’excès de bruit dans certain type d’espace. À la moindre expérience de mobilité, au moindre mouvement nous éprouvons l’épaisseur et l’importance de la spatialité. Nous l’éprouvons aussi chaque fois que nous avons besoin de prendre place, chaque fois que nous avons besoin de choisir un endroit. Nous sommes en train de faire l’interview dans un petit estaminet, au moment de nous assoir, nous avons hésité, quelques dixièmes de seconde, pourquoi est-ce j’ai choisi cette chaise alors que vous pensiez plutôt m’en faire choisir une autre, nous avons eu un dilemme spatial qui a été tranché parce que, comme vous m’invitez, vous avez considéré que c’était à moi de choisir, et moi j’ai choisi en fonction d’une proximité plus évidente de silence, mais voilà, nous avons eu une épreuve de placement, et la richesse et la complexité de cela, d’échanges tacites dans l’interaction qui n’a même pas besoin d’être objectivé par le langage, je suis en train de l’objectivé, mais il a été tranché sans qu’il ait été nécessaire de le verbaliser.
J’aime beaucoup le cinéma de Jacques Tati. — Michel Lussault

Dans le comique du cinéma de Jacques Tati, il y a énormément de dilemmes spatiaux, la drôlerie surgit du fait que le personnage décode mal les éléments de l’épreuve spatiale qu’il a géré. C’est un des ressorts du burlesque. Le burlesque n’est pas temporel, il est essentiellement spatial. Le comique qui joue avec le temps n’est pas du tout de même ordre. Et si nous avons à franchir une limite, par exemple si nous avons à prendre un avion, nous savons ce qu’il en coûte de traverser des sas, des seuils, des contrôles. Lorsque j’ai pris le train à Paris pour venir à Lille, il a fallu que je passe mon code de billet devant un des nouveaux portiques qui a été mis en place à la gare du Nord. C’était la première fois que j’avais à le faire, et bien, je ne savais pas comment faire. J’ai été aussi, là, confronté à un problème de spatialité. En fait, nous éprouvons en permanence l’espace. Mais ce qui est particulier, c’est que nous en parlons très peu. L’espace est l’épreuve qui renvoie à l’épreuve de la distance, à l’épreuve de l’emplacement, l’épreuve du franchissement, à l’épreuve du parcours.
 Dans
une certaine mesure aussi, l’espace est plus lié à nos corps, à la nécessité de
toujours partir du corps. Le temps nous le ruminons, c’est Paul Ricœur qui
parlait de la rumination inconclusive
du temps. D’ailleurs Ricœur disait dans Temps et récit, pour
sortir de la rumination inconclusive
du temps, que l’homme a un outil spécifique qui est la narrativité, l’histoire
qu’on raconte. L’espace, dans notre expérience, n’est pas spontanément narratif,
il est plutôt de l’ordre de la description, il est plutôt de l’ordre du constat,
de l’observation. Je crois donc qu’il y a un vécu très riche de l’espace, qui
est un vécu sensoriel, vécu corporel, qui évidemment est un vécu cognitif, nous
sommes des animaux spatiaux, nous codons et décodons l’espace, mais nous
peinons souvent à l’objectiver par le langage, ou alors nous trouvons d’autres
types de langage, la photo, la peinture, la carte – ah le miracle de la
carte ! Cette carte que nous aimons tant ! Le GPS aujourd’hui, sur
les outils portables, nous projette dans un espace très étrange puisque par
rapport à la carte classique qui est exocentrée, sur le téléphone portable, nos
projections cartographiques sont égo-centrées puisque le point bleu, c’est
nous. Je pense que l’espace est toujours là, toujours avec nous, je ne dis
jamais que nous agissons sur l’espace, mais avec, l’espace à la fois nous
entoure, nous traverse, nous accueille, nous enclot, et cet espace est à la
fois omniprésent et toujours équivoque. J’ai été très marqué par une phrase de
Georges Perec dans Espèces d’espaces.
Dans
une certaine mesure aussi, l’espace est plus lié à nos corps, à la nécessité de
toujours partir du corps. Le temps nous le ruminons, c’est Paul Ricœur qui
parlait de la rumination inconclusive
du temps. D’ailleurs Ricœur disait dans Temps et récit, pour
sortir de la rumination inconclusive
du temps, que l’homme a un outil spécifique qui est la narrativité, l’histoire
qu’on raconte. L’espace, dans notre expérience, n’est pas spontanément narratif,
il est plutôt de l’ordre de la description, il est plutôt de l’ordre du constat,
de l’observation. Je crois donc qu’il y a un vécu très riche de l’espace, qui
est un vécu sensoriel, vécu corporel, qui évidemment est un vécu cognitif, nous
sommes des animaux spatiaux, nous codons et décodons l’espace, mais nous
peinons souvent à l’objectiver par le langage, ou alors nous trouvons d’autres
types de langage, la photo, la peinture, la carte – ah le miracle de la
carte ! Cette carte que nous aimons tant ! Le GPS aujourd’hui, sur
les outils portables, nous projette dans un espace très étrange puisque par
rapport à la carte classique qui est exocentrée, sur le téléphone portable, nos
projections cartographiques sont égo-centrées puisque le point bleu, c’est
nous. Je pense que l’espace est toujours là, toujours avec nous, je ne dis
jamais que nous agissons sur l’espace, mais avec, l’espace à la fois nous
entoure, nous traverse, nous accueille, nous enclot, et cet espace est à la
fois omniprésent et toujours équivoque. J’ai été très marqué par une phrase de
Georges Perec dans Espèces d’espaces.
L’espace est un doute. — Georges Perec
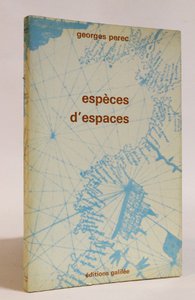 L’espace
est toujours questionnant et questionné. Mais c’est un doute qui n’est pas d’ordre
métaphysique, comme l’est la réflexion sur le temps, c’est un doute qui est
presque géophysique, c’est-à-dire de l’ordre d’une physique immédiate, d’une
immédiateté de la relation concrète au vécu. Parce que même si l’espace est
immatériel, à travers les images, les imaginaires, les idéologies, les valeurs,
les normes, les règles, les fantasmes, les affections qu’il porte et supporte,
l’espace a toujours à voir avec le concret. Avec le matériel.
L’espace
est toujours questionnant et questionné. Mais c’est un doute qui n’est pas d’ordre
métaphysique, comme l’est la réflexion sur le temps, c’est un doute qui est
presque géophysique, c’est-à-dire de l’ordre d’une physique immédiate, d’une
immédiateté de la relation concrète au vécu. Parce que même si l’espace est
immatériel, à travers les images, les imaginaires, les idéologies, les valeurs,
les normes, les règles, les fantasmes, les affections qu’il porte et supporte,
l’espace a toujours à voir avec le concret. Avec le matériel.

- Dans votre analyse des hyper-lieux tels que grand aéroport ou méga mole commercial, vous prenez le contre-pied des critiques habituelles. Ces espaces ont été décrits quelques fois comme « non-lieux », en tout cas inertes, vides d’expériences. Vous montrez que ce n’est pas possible et que ces endroits emblématiques de la mondialisation fourmillent d’expériences. Mais qu’ils soient des espaces riches en expérience suffit-il à dire qu’ils ne créent pas de l’aliénation ? Lors d’un colloque sur la ville, on donnait la parole à des adolescents et l’un d’eux, pour décrire ce qu’il y avait de mieux en ville, là où il se sentait le mieux avec ses copains, et comme exemple de ce que devrait être avant tout l’espace urbain, citait le grand centre commercial de sa cité…
- D’abord, pour m’expliquer sur ça, qui est important, il ne peut pas ne pas y avoir d’expérience spatiale. C’est impossible. On ne suspend jamais l’expérience spatiale, pas plus qu’on ne suspend le temps. « O temps suspend ton vol » dit le poète, comme une réclamation, on sait ce qu’il en est advenu, il est mort comme les autres, le temps ne s’est pas arrêté. « O espace suspend ton empire », c’est tout autant impossible. Même lorsqu’on dort, même lorsqu’on tweete, lorsqu’on est sur facebook, et de plus en plus au fur et à mesure que les appareils communicationnels deviennent portables, on ne suspend jamais la dimension spatiale de l’existence. Ça fait peut-être comprendre une formule que j’emploie souvent, qui me vaut pas mal de critiques, quand je dis que pour moi aucun espace n’est inhabitable. Au sens où j’ai défini tout à l’heure l’habitation. Aucun espace n’est inhabitable. Le campement de Calais était terrible, c’était un drame, mais il était habité. Et dire cela n’est pas émettre le moindre jugement de valeur. C’est simplement un constat et une proposition théorique nourrie par l’empirique. Le camp de concentration est habitable. Ce n’est pas pour ça que je trouve que c’est une expérience habitationnelle enviable et recommandée. Néanmoins, il faut constater une chose, c’est que, tous ceux qui en sont revenus n’ont jamais pu se remettre de cette expérience-là. Cette expérience a été définitive, dans ce qu’elle avait de profondément insupportable et ce n’est pas un hasard si un des plus grands livres sur les camps, écrit par Primo Levi, s’appelle Si c’est un homme. Parce que Primo Levi questionne l’habitabilité du camp de concentration. Et peut-être que là, effectivement, nous sommes arrivés à un moment où, par hypothèse, le camp devenait pratiquement inhumain, donc inhabitable. L’inhabitable c’est l’inhumain. C’est très important pour moi, de ne pas céder sur cela, c’est le cœur de mon projet.
Après, il est clair que la valeur de ces expériences
spatiales est extrêmement variable selon les conditions dans lesquelles ces
expériences se réalisent. Et dans ces conditions interviennent la biographie du
sujet, les conditions sociales du moment, les capacités d’agir de l’individu, son
état psychologique, son état d’âme… Vous pouvez être pauvre et guilleret, et
vivre très bien une expérience que d’autres trouveront terribles. Vous pouvez
au contraire être extrêmement riche et morose !
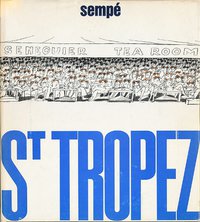 Je ne
sais pas si vous connaissez un album d’un dessinateur métaphysique français,
Sempé, un album qui s’appelle Saint-Tropez où l’on voit des gens
très riches, dans les années 1960, qui s’emmerdent au bord de leurs piscines set
de leurs yachts. Sempé est caustique mais aussi interrogatif, et à la limite,
il n’y a pas de jugement moral là-dedans, il montre ce qu’il en est d’une sorte
d’ennui dans une expérience d’un lieu pourtant somptueux ! La valeur d’une
expérience est liée à tellement de conditions ! Lorsque vous regardez des
migrants dans un campement, et que de toute force vous lui dites, « ah
vous vous sentez mal, hein, vous devez souffrir ? », et que le
migrant vous dit « non, non, ça va , je m’en fous, puis j’ai une vision,
c’est pas si mal, c’est toujours mieux ici que à Kaboul ou qu’à Damas » et
que vous insistez « mais non, mais non, tu ne peux pas te sentir bien
ici », une sorte de forçage pour ne pas rendre possible la valorisation
d’une expérience que soi on n’estime pas enviable. C’est un peu le même quand
des adolescents disent « on adore les centres commerciaux » et qu’on
leur répond « mais non, vous ne pouvez pas aimer ça, pas les centres
commerciaux, pas les aéroports ! » Et si ! Avec les sciences
sociales, il faut constater que des gens aiment ces lieux et comprendre ce que
ça veut dire comme expérience.
Je ne
sais pas si vous connaissez un album d’un dessinateur métaphysique français,
Sempé, un album qui s’appelle Saint-Tropez où l’on voit des gens
très riches, dans les années 1960, qui s’emmerdent au bord de leurs piscines set
de leurs yachts. Sempé est caustique mais aussi interrogatif, et à la limite,
il n’y a pas de jugement moral là-dedans, il montre ce qu’il en est d’une sorte
d’ennui dans une expérience d’un lieu pourtant somptueux ! La valeur d’une
expérience est liée à tellement de conditions ! Lorsque vous regardez des
migrants dans un campement, et que de toute force vous lui dites, « ah
vous vous sentez mal, hein, vous devez souffrir ? », et que le
migrant vous dit « non, non, ça va , je m’en fous, puis j’ai une vision,
c’est pas si mal, c’est toujours mieux ici que à Kaboul ou qu’à Damas » et
que vous insistez « mais non, mais non, tu ne peux pas te sentir bien
ici », une sorte de forçage pour ne pas rendre possible la valorisation
d’une expérience que soi on n’estime pas enviable. C’est un peu le même quand
des adolescents disent « on adore les centres commerciaux » et qu’on
leur répond « mais non, vous ne pouvez pas aimer ça, pas les centres
commerciaux, pas les aéroports ! » Et si ! Avec les sciences
sociales, il faut constater que des gens aiment ces lieux et comprendre ce que
ça veut dire comme expérience.
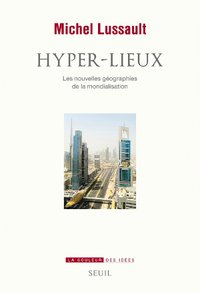 Et du coup, ça me permet aussi d’insister sur
quelque chose : dans mon livre, Hyper-Lieux,
pendant quelques pages, lorsque je décris l’expérience de l’aéroport, je montre
une expérience spatiale qui peut être considérée comme riche et j’en viens à
faire une comparaison qui est, je le sais, pour certains lecteurs, scandaleuses.
C’est-à-dire j’utilise la description du flâneur urbain par Baudelaire comme
pouvant modéliser le promeneur de l’aéroport. Je rapproche donc deux régimes
d’expérience que spontanément, les intellectuels lettrés vont opposer. Baudelaire
sera du côté de l’authenticité culturelle la plus forte de l’expérience
poétique du monde, le promeneur de l’aéroport sera du côté de l’aliénation par
la structure, la fonction de l’urbanisation contemporaine. Ce que je dis c’est
que quand on regarde les deux, et quand on lit Baudelaire, on peut utiliser les
termes de Baudelaire pour décrire ce qui se passe dans l’aéroport. Je n’en
conclus par autre chose qu’une interrogation : n’avons-nous pas là la
figure du flâneur contemporain ? C’est une manière de vous répondre sur les
stéréotypes. D’abord, il faut toujours se méfier des stéréotypes et il faut
essayer de dire deux choses : un, les stéréotypes ont toujours existé, du
temps de Baudelaire comme aujourd’hui, finalement le flâneur baudelairien ou
benjaminien, c’est peut-être aussi un stéréotype. Peut-être que tout
simplement, l’être humain a besoin de stéréotypes pour vivre, et
particulièrement, les stéréotypes spatiaux qui font partie de ce que je nomme
l’imagination géographique des individus, parce que les individus ont besoin
d’imagination géographique pour traverser leurs épreuves spatiales. Et puis,
ensuite, il faut essayer de déconstruire les stéréotypes, comprendre d’où ils
viennent. Il y a un stéréotype condescendant par rapport aux centres
commerciaux, qui est intéressant, et qui est porteur de sens, même si c’est un
stéréotype, parce qu’il insiste à raison sur le fait que certain capitalisme
marchand est problématique. On peut donner un certain crédit à ce stéréotype,
d’ailleurs dans mon livre, je suis assez sévère sur le centre commercial de
Dubaï. Mais à l’inverse, il faut comprendre ce que disent les adolescents
lorsqu’ils disent qu’ils aiment « expériencier », de manière
affinitaire avec d’autres adolescents, ces lieux-là. Qu’est-ce que ça révèle de
ce qu’il en est d’être adolescent dans le monde contemporain. Ma position
empirique est de considérer les choses telles qu’elles sont, pas forcément
telles qu’on voudrait qu’elles fussent, et essayer de toujours déconstruire
cela est intéressant parce qu’elles donnent, en fait, plus de possibilités de
comprendre la complexité des situations. Et pour terminer, je dis très souvent
la chose suivante à mes étudiants, ou à mes auditeurs : l’espace de nos
vies est équivoque, toujours équivoque, il ne se laisse jamais saisir facilement.
Je retrouve Perec ! L’espace est un doute, l’espace est équivoque !
On ne sait jamais sur quel pied danser avec l’espace !
Et du coup, ça me permet aussi d’insister sur
quelque chose : dans mon livre, Hyper-Lieux,
pendant quelques pages, lorsque je décris l’expérience de l’aéroport, je montre
une expérience spatiale qui peut être considérée comme riche et j’en viens à
faire une comparaison qui est, je le sais, pour certains lecteurs, scandaleuses.
C’est-à-dire j’utilise la description du flâneur urbain par Baudelaire comme
pouvant modéliser le promeneur de l’aéroport. Je rapproche donc deux régimes
d’expérience que spontanément, les intellectuels lettrés vont opposer. Baudelaire
sera du côté de l’authenticité culturelle la plus forte de l’expérience
poétique du monde, le promeneur de l’aéroport sera du côté de l’aliénation par
la structure, la fonction de l’urbanisation contemporaine. Ce que je dis c’est
que quand on regarde les deux, et quand on lit Baudelaire, on peut utiliser les
termes de Baudelaire pour décrire ce qui se passe dans l’aéroport. Je n’en
conclus par autre chose qu’une interrogation : n’avons-nous pas là la
figure du flâneur contemporain ? C’est une manière de vous répondre sur les
stéréotypes. D’abord, il faut toujours se méfier des stéréotypes et il faut
essayer de dire deux choses : un, les stéréotypes ont toujours existé, du
temps de Baudelaire comme aujourd’hui, finalement le flâneur baudelairien ou
benjaminien, c’est peut-être aussi un stéréotype. Peut-être que tout
simplement, l’être humain a besoin de stéréotypes pour vivre, et
particulièrement, les stéréotypes spatiaux qui font partie de ce que je nomme
l’imagination géographique des individus, parce que les individus ont besoin
d’imagination géographique pour traverser leurs épreuves spatiales. Et puis,
ensuite, il faut essayer de déconstruire les stéréotypes, comprendre d’où ils
viennent. Il y a un stéréotype condescendant par rapport aux centres
commerciaux, qui est intéressant, et qui est porteur de sens, même si c’est un
stéréotype, parce qu’il insiste à raison sur le fait que certain capitalisme
marchand est problématique. On peut donner un certain crédit à ce stéréotype,
d’ailleurs dans mon livre, je suis assez sévère sur le centre commercial de
Dubaï. Mais à l’inverse, il faut comprendre ce que disent les adolescents
lorsqu’ils disent qu’ils aiment « expériencier », de manière
affinitaire avec d’autres adolescents, ces lieux-là. Qu’est-ce que ça révèle de
ce qu’il en est d’être adolescent dans le monde contemporain. Ma position
empirique est de considérer les choses telles qu’elles sont, pas forcément
telles qu’on voudrait qu’elles fussent, et essayer de toujours déconstruire
cela est intéressant parce qu’elles donnent, en fait, plus de possibilités de
comprendre la complexité des situations. Et pour terminer, je dis très souvent
la chose suivante à mes étudiants, ou à mes auditeurs : l’espace de nos
vies est équivoque, toujours équivoque, il ne se laisse jamais saisir facilement.
Je retrouve Perec ! L’espace est un doute, l’espace est équivoque !
On ne sait jamais sur quel pied danser avec l’espace !
- Vous avez eu cette phrase intéressante tout à l’heure dans votre conférence : « Quand je vois quelque chose qui fait bouger les humains, je le prends toujours au sérieux ».
- Tout à fait. Et tout ce qui fait bouger les humains est équivoque, contrairement à ce que les humains veulent bien raconter. Et nos relations à cet espace équivoque sont ambiguës. Et on trouve encore chez Perec, dans Espèces d’espaces, un texte construit de la manière suivante : « J’aime le bus 58, mais parfois non », « J’aime marcher le long des boulevards maréchaux, mais parfois non », « Je n’aime pas la Porte Saint-Martin, mais parfois oui », « J’aime venir à Lille, mais parfois non ». C’est cela que j’entends par ambiguïté de nos relations à l’espace. Si vous couplez équivocité et ambiguïté, vous avez toute la richesse des situations spatiales, et c’est pour ça que vous êtes obligés de prendre au sérieux ce qui fait bouger spatialement un individu, parce que c’est la vie même que vous observez dans son caractère fait d’équivoque et d’ambiguïté.

- Vous parlez dans votre livre de l’importance d’inventer de nouvelles narrativités par rapport au récit dominant, univoque. Vous soulignez que ces narrativités alternatives existent, mais ne sont pas assez prises en compte. Mais tout le monde a-t-il la capacité d’inventer de nouvelles narrativités ?
- Je crois, je le pense même. Sauf les muets, bien entendu, mais encore. Je pense que c’est quelque chose de frappant… Vous savez, à Calais, dans tous les campements, les récits sont innombrables. Simplement, on ne les écoute pas. On confond souvent l’absence d’écoute et l’absence de capacité narrative. Il y a beaucoup de reportages qui sont faits, par les uns et par les autres, notamment ceux qui ont été faits à partir d’une proposition de la BBC qui a confié des smartphones à des migrants, pour qu’ils fassent une sorte d’auto-documentaire sur leur migration : ils racontent des histoires. Ils racontent des histoires qui sont des histoires de vie, ce sont des histoires temporalisées, mais ils racontent aussi, décrivent des trajets et des passages, des expériences d’espace. Je n’ai jamais rencontré jusqu’à présent d’individu qui soit privé de la capacité narrative. Il le fera avec son régime propre d’énonciation, mais tous les individus sont capables de narrer leur existence, de documenter, décrire les cadres de leurs expériences, y compris les cadres spatiaux. Simplement, il faut qu’on le leur demande, il faut qu’on les écoute. À Calais, les co-habitants de la Jungle, une partie, parce que c’était très compliqué à Calais, s’est auto-organisée et a décidé d’élire des représentants. Et ces représentants ont demandé à la marie de Calais de les recevoir. Ils voulaient montrer à la mairie qu’ils étaient capables de parler du camp, de leurs projets, ils voulaient explicitement s’inscrire dans le champ d’une interaction politique. Ils avaient aussi la volonté de réfléchir à ce que les occupants du camp pouvaient proposer aux calaisiens. Nous sommes là dans la construction d’un récit autre. Où les migrants deviennent aussi force de proposition. Inutile de vous dire que la mairie de Calais ne leur a jamais répondu. Ce n’est pas d’absence de récit qu’il aurait fallu parler, c’est plutôt de surdité volontaire pour le récit des « vaincus ».
- La manière d’altérer et faire évoluer la narration dominante est donc de combattre cette surdité, de promouvoir l’écoute, la prise en considération. Pour que les récits des vaincus intègrent le récit dominant, il faut une interaction politique. Vous n’êtes pas le seul à le dire, mais vous êtes très clair à ce propos : avec Calais, on a raté quelque chose, on a raté peut-être le début d’une nouvelle installation humaine…
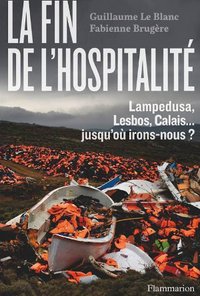 - On a tout raté. Bien sûr, là, il se passait la
vie, la vie, dans son caractère terrible, comme disait l’autre, cette maladie
sexuellement transmissible dont on ne guérit jamais. Dans son caractère
terrible quand c’est une vie de pauvreté et de dénuement, mais vous savez, un
philosophe qui s’appelle Guillaume Le Blanc qui a écrit récemment avec sa
compagne Fabienne Brugère, un livre sur l’hospitalité, disait qu’il ne faut
pas croire que la condition de pauvreté ne signifie pas que les vies soient
pauvres. Les vies peuvent être intenses, dures, pénibles, il ne s’agit pas de
le nier, je n’ai jamais dit le contraire. PEROU disait d’ailleurs que Calais
c’est à la fois un drame et une chance. Les conditions de vie sont bien
terribles mais, il y a un désir d’agir, alors, « désir », c’est un
mot compliqué en français, parce quand on pense désir en français on y met
quelque chose de très freudien, l’anglais est plus neutre, il n’emploie pas
« desire » mais plutôt « will » qu’on traduit, nous, par
« volonté », mais ce n’est pas exactement ça non plus. Je veux parler
du désir en tant que projection dans l’action. Un philosophe canadien
anglophone, Charles Taylor, dans un livre « Les sources du moi »
écrivait que l’action, c’est du désir projeté dans l’espace public, désir au
sens de protention, de tension à
aller vers l’extérieur. Et bien, il y a du désir dans les vies pauvres, y
compris, du reste, du désir au sens freudien. La vraie question n’est pas que
ça existe ou que ça n’existe pas, la vraie question c’est « qu’en
fait-on ? ». Comment le considère-t-on ? Je n’ai pas d’expérience
anthropologique du campement de Calais comme ont Michel Agier et Sébastien
Thierry, je me suis contenté, en observant, de me dire, tiens, je vais pouvoir,
non pas décrire Calais et les conditions, parce que ça, ça a déjà été fait, et
mieux que je ne saurais le faire, mais plutôt justement essayer de comprendre
les récits de Calais, les types de narrativité qui étaient utilisés pour
qualifier la Jungle et donc de montrer, en fait, à quel point, l’État, la
mairie de Calais, les partis d’extrême droite, refusaient à toute force
d’entendre et même d’écouter les autres narrations qui étaient faites sur
Calais et qui présentaient Calais comme le début d’une installation humaine.
- On a tout raté. Bien sûr, là, il se passait la
vie, la vie, dans son caractère terrible, comme disait l’autre, cette maladie
sexuellement transmissible dont on ne guérit jamais. Dans son caractère
terrible quand c’est une vie de pauvreté et de dénuement, mais vous savez, un
philosophe qui s’appelle Guillaume Le Blanc qui a écrit récemment avec sa
compagne Fabienne Brugère, un livre sur l’hospitalité, disait qu’il ne faut
pas croire que la condition de pauvreté ne signifie pas que les vies soient
pauvres. Les vies peuvent être intenses, dures, pénibles, il ne s’agit pas de
le nier, je n’ai jamais dit le contraire. PEROU disait d’ailleurs que Calais
c’est à la fois un drame et une chance. Les conditions de vie sont bien
terribles mais, il y a un désir d’agir, alors, « désir », c’est un
mot compliqué en français, parce quand on pense désir en français on y met
quelque chose de très freudien, l’anglais est plus neutre, il n’emploie pas
« desire » mais plutôt « will » qu’on traduit, nous, par
« volonté », mais ce n’est pas exactement ça non plus. Je veux parler
du désir en tant que projection dans l’action. Un philosophe canadien
anglophone, Charles Taylor, dans un livre « Les sources du moi »
écrivait que l’action, c’est du désir projeté dans l’espace public, désir au
sens de protention, de tension à
aller vers l’extérieur. Et bien, il y a du désir dans les vies pauvres, y
compris, du reste, du désir au sens freudien. La vraie question n’est pas que
ça existe ou que ça n’existe pas, la vraie question c’est « qu’en
fait-on ? ». Comment le considère-t-on ? Je n’ai pas d’expérience
anthropologique du campement de Calais comme ont Michel Agier et Sébastien
Thierry, je me suis contenté, en observant, de me dire, tiens, je vais pouvoir,
non pas décrire Calais et les conditions, parce que ça, ça a déjà été fait, et
mieux que je ne saurais le faire, mais plutôt justement essayer de comprendre
les récits de Calais, les types de narrativité qui étaient utilisés pour
qualifier la Jungle et donc de montrer, en fait, à quel point, l’État, la
mairie de Calais, les partis d’extrême droite, refusaient à toute force
d’entendre et même d’écouter les autres narrations qui étaient faites sur
Calais et qui présentaient Calais comme le début d’une installation humaine.
- C’est très fort de qualifier cela en termes de « début d’une installation humaine ». Cela permet de prendre conscience qu’effectivement, il y avait, là, la chance de voir naître une autre ville.
- C’est un pari, mais après tout, nous sommes à Lille, nous serons à Bruxelles, si nous revenons deux mille ans plus tôt, je ne suis pas sûr que les premiers lillois étaient moins enguenillés que les habitants de la Jungle qui ont un avantage par rapport aux lillois d’il y a 2000 ans, c’est d’avoir des smartphones ! Non, mais très sérieusement, ça me fascine, qu’est-ce que ça dit de notre incapacité, nous désormais dans des pays développés, à comprendre ce qu’il en est des processus d’installation les plus pauvres, qu’est-ce que ça dit de ce que nous pensons être la normalité de l’habitation… Finalement, nous n’acceptons plus qu’il y ait – je suis mal compris quand je dis ça, mais peu importe – qu’il y ait des carrières précaires de l’habitation, vous voyez, des trajectoires précaires. On a l’impression que maintenant pour réussir il faut être petit bourgeois propriétaire de son pavillon, ou de sa maison, avec un travail salarié, mais pendant longtemps le peuple urbain était aussi un peuple précaire, il y a eu des carrières populaires réussies.
- Dans le dernier film de Claire Simon, on voit des personnes qui font le choix de la précarité, une précarité « non subie »…
- Oui, elle montre cela et dans mon livre, je parle des gens qui font le choix de se couper des réseaux… Vous voyez, ce que je trouve étrange par rapport à Calais, il y avait quelques milliers de personnes, dans un pays de 66 millions d’habitants, une commune qui par ailleurs est une commune en crise, avec énormément de logements libres, et il y a des gens qui arrivent là avec des diplômes, avec la volonté de ne pas rester… Comment comprendre ce qui s’est passé ? Sans jugement moral, comment comprendre qu’on n’ait pas pu accepter d’autres manières, en faire simplement état. Dans mon précédent livre, une des exergues, - j’aime beaucoup les phrases d’exergues, dans ce livre, il y a beaucoup d’allusions et citations, ce sont des jeux, mais des jeux qui ont du sens -, je reprenais la première phrase du Tractatus philosophicus de Wittgenstein, en français, « le monde est ce qui arrive », mais en allemand ça veut plutôt dire « le monde est ce qui est le fait ». Wittgenstein, par-là, dit que le monde, c’est ce qui est là, et bien Calais, c’était là, la Jungle, elle était là. Pourquoi n’a-t-on pas voulu faire de la Jungle un monde, au sens de Wittgenstein ? Pourquoi en a-t-on fait un chancre, un cancer, un lieu du trouble ? Ca en dit long, pas tellement sur les migrants de Calais, ça en dit long sur nous, sur les calaisiens, ce n’est pas forcément reluisant. Dans le livre, c’est aussi ça qui m’a travaillé, et je comprends que ça puisse choquer, je comprends qu’on puisse me dire « c‘est facile pour toi, tu n’habitais pas à 50 mètres », j’accepte tout ça, mais je pense néanmoins qu’il est difficile de balayer d’un revers de main tout ce qui écrit là, dans ce livre, sur Calais.
- Vous écrivez qu’on n’est pas attaché à un espace unique. Nous en traversons de multiples, nous sommes faits d’espaces multiples, c’est cela qui nourrit notre narrativité. Est-ce une manière de contrecarrer les pensées du territoire, du terroir, des frontières et des identités liées aux lieux de naissance ?
- Il y a aujourd’hui un renouveau incontestable de ce que j’appelle les idéologies spatiales identitaires, c’est-à-dire des idéologies qui sont des assignations, locales et territoriales, en gros qui prétendent que le lieu natal, le sol natal, ou le lieu d’appartenance doit saturer absolument tout le champ de la définition de l’identité du sujet, de l’individu. Ces idéologies d’assignation, elles se retrouvent, à la fois du côté de certaines forces politiques d’extrême droite, mais aussi à l’extrême gauche, du côté d’un certain type de localisme, elles se retrouvent aussi dans certaines pensées écologiques autour de la mythologie du local, de la consommation locale, de la production locale, comme si finalement, en-dehors du local, et d’un local communautaire il n’y avait pas de salut possible et que tout ce qui était extra-locale était une menace ou une source d’aliénation. Cette imagination géographique est contredite par l’observation des pratiques, en fait, les localismes ne le sont jamais, c’est une pose la plupart du temps. Le fait est que la grande majorité des individus est, comme dirait un collègue géographe, polytopique, elle investit dans son habitat, des espaces différents, plusieurs localités, et des espaces qui peuvent aller jusqu’à l’espace du monde entier quand, par exemple, on est touristes. Dans certains milieux, il est de très mauvais ton de dire qu’on est touriste, le touriste est un idiot du voyage, alors que soi-même on se dit plutôt voyageur, ce n’est pas la même chose, mais enfin globalement, on est quand même touriste ! Quand on regarde les humains contemporains, on s’aperçoit qu’ils bougent, qu’ils se délocalisent et se relocalisent en permanence. Donc, il faut considérer cette imagination identitariste pour ce qu’elle est, un symptôme, un malaise culturel et politique, qui est lié à mon sens au fait que, justement, la mondialisation urbaine brouille les cartes et se manifeste par l’importance de la délocalisation. C’est un symptôme de la mondialisation. On feint d’y croire parce que ça rassure, c’est un récit, c’est une narrativité, c’est une fiction consolatrice. Comme toute les fictions consolatrices, elles sont estimables, intéressantes, dangereuses lorsqu’elles conduisent à considérer que l’on peut revendiquer une quelconque suprématie parce qu’on est du cru, parce qu’on est de ce local-là. C’est bien ce qui a fonctionné à Calais et ailleurs, avec des variations très diverses dans la définition de ce qui permet de se dire du cru. À Calais, il y a beaucoup de gens qui ne sont nés dans le calaisis mais qui se sont auto-proclamés du cru. Il suffit d’être un tard venu pour être un parvenu, comme disait Bourdieu. Les derniers venus sont considérés comme allogènes par d’autres qui ne sont pas beaucoup moins allogènes qu’eux, parce que ce sont aussi des délocalisés. Ça ne manque d’ailleurs pas de sel à Calais qui a toujours été un espace en mouvement, marqué par les traversées comme tous les espaces portuaires. Voilà, ces fictions consolatrices, elles m’intéressent, elles m’inquiètent politiquement, et je crois qu’on peut les penser comme des expressions de ce que la mondialisation produit comme brouillage des références. Dans une certaine mesure, on peut dire que, en raison même de ce qu’est la mondialisation urbaine, nous ne savons plus où nous habitons. Dans les vieilles sociétés, les sociétés d’enracinement comme les nôtres, la pensée des racines est aussi un travestissement dont on se gargarise à tort. Parce que lorsque l’on regarde l’histoire des familles, ce que sait aussi toute personne faisant son arbre généalogique, l’enracinement dans le local est en général très faible. Il remonte très rarement au-delà de trois générations, ne serait-ce qu’en raison de l’urbanisation. Pratiquement toute famille a connu un exode rural, ce qui équivaut à un déracinement, de proximité, certes, mais un déracinement quand même. Dans des sociétés comme les nôtres qui ont mythifié un enracinement, typiquement des sociétés européennes marquées par l’idéologie géopolitique territoriale, on a l’impression que la mondialisation nous fait perdre nos lieux, que l’on est sans feu ni lieu et, pour essayer de l’accepter, on est parfois tenté de chercher ces fictions consolatrices dont je parlais.
Entretien réalisé par Pierre Hemptinne
lors
d’une conférence de Michel Lussault à la Fnac de Lille (dans le cadre de
Cité-Philo 2017, Que croyez-vous ?)