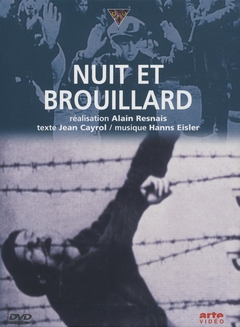Nuit et brouillard (Alain Resnais)

Ils sont en face de moi, l’œil rond, et je me vois soudain dans ce regard d’effroi : leur épouvante. Depuis deux ans je vivais sans visage… — Jorge Semprun, "L'Écriture ou la vie"
Le sentiment de notre existence dépend pour une bonne part du regard que les autres portent sur nous : aussi peut-on qualifier de non-humaine l’expérience de qui a vécu des jours où l’homme a été un objet aux yeux de l’homme. — Primo Levi, "Si c'est un homme"
Nacht und Nebel – N.N. – Nuit et Brouillard. Par ces mots, les nazis désignaient une catégorie de déportés résistants ou de race « impure » - jugés par eux comme les plus dangereux et promis à une extermination rapide dans des camps concentrationnaires. — –
Enfant dans les années soixante, ma relation avec les images audiovisuelles se limitait pour ainsi dire aux émissions de la télévision scolaire auxquelles j’assistais dans la modeste salle des fêtes de mon école primaire, en compagnie d’une douzaine d’autres gamins, à raison de deux ou trois séances par trimestre. De ces programmes, toujours en noir et blanc, j’ai pratiquement tout oublié, à l’exception d’une séquence sur la sexualité des animaux et de la diffusion, un après-midi de mai, du film d’Alain Resnais Nuit et brouillard, maintes fois revu depuis, dont j’ignorais évidemment à l’époque qu’il représentait l’honneur même du cinéma et qu’il serait plus tard à la base de mon rapport à cet art, comme il le fut pour tant d’autres avant moi. Ce moment fut important, peut-être même fondateur, au point que je n’ai jamais pu parler de Nuit et brouillard sans évoquer la mémoire de mon instituteur, les multiples précautions qu’il avait prises ce jour-là avant de nous le présenter, sa douceur à notre égard dans la semaine qui suivit et, surtout, le silence qui nous avait ensuite accompagné au sortir de la projection, nous d’ordinaire si bavards, tandis qu’en rang par deux nous montions avec lui jusqu’en haut du village, à la rencontre d’une rescapée du camp de Ravensbrück. De l’école à sa maison, dans l’intervalle de la marche, tandis que nous progressions de plus en plus graves, en nous les images du film commençaient à faire dépôt – empilements de corps décharnés, monstrueux entassements de chaussures, de lunettes ou de cheveux tondus, regards à la caméra de survivants exsangues, vidés de toute expression : des images dont nous savions déjà, même intuitivement, qu’elles ne nous quitteraient jamais. Nous avions dix ou onze ans et sans doute étions-nous trop jeunes pour prendre exactement la mesure de la spécificité de l’Holocauste ; il n’empêche que quelque chose d’essentiel nous avait été transmis, par Alain Resnais d’abord, par notre instituteur à sa suite, comme s’ils s’étaient passé le relais : la conscience qu’un événement d’une horreur indépassable s’était produit dans l’histoire des hommes, affectant l’espèce humaine dans sa définition même, dont l’ampleur nécessitait un tel dispositif scolaire d’exception pour être dite à des enfants.
Nombreux sont ceux qui témoignèrent par la suite de cette expérience unique où, pour la première fois peut-être dans un cadre scolaire, le passé fut transmis par la puissance réflexive des images et non plus par le texte. En ouverture de Persévérance *, son dernier livre, paru deux ans après sa mort, Serge Daney fait ainsi remonter à sa découverte de Nuit et brouillard au lycée Voltaire, en 1959, sa décision de consacrer sa vie à l’analyse des images d’un point de vue de cinéma. Ces quelques lignes, souvent citées, comptent parmi les plus fortes qu’il ait écrites :
Étrange baptême des images : comprendre en même temps que les camps étaient vrais et que le film était juste. Et que le cinéma – lui seul ? – était capable de camper aux limites d’une humanité dénaturée. Je sentais que les distances mises par Resnais entre le sujet filmé, le sujet filmant et le sujet spectateur étaient, en 1959 comme en 1955, les seules possibles. Nuit et brouillard, un « beau » film ? Non, un film juste. (…)Aucune « belle image » ne me tiendrait quitte de l’émotion – crainte et tremblement – devant les choses enregistrées. (…) Les corps de Nuit et brouillard et, deux ans plus tard, ceux des premiers plans d’Hiroshima mon amour sont de ces « choses » qui m’ont regardé plus que je ne les ai vues. (…) C’était donc par le cinéma que je sus que la condition humaine et la boucherie industrielle n’étaient pas incompatibles et que le pire venait juste d’avoir lieu — Serge Daney, "Persévarance"
Nuit et brouillard : un film juste. De fait, la représentation de la Shoah pose des questions nouvelles aux cinéastes, nées de la spécificité même du génocide : extermination systématique des juifs d’Europe, pensée puis planifiée de façon scientifique, à échelle industrielle ; recyclage automatique des déchets ; refus de sépultures ; disparition de toute preuve et de toute trace de leur existence.
Que peut l’histoire, que peut l’image cinématographique, que peuvent-elles ensemble face à la volonté que n’ait pas été ce qui a été ? L’extrême de cette volonté, on le sait, se nomme en allemand "Vernichtung" : réduction à rien, c’est-à-dire anéantissement mais aussi anéantissement de cet anéantissement — Jacques Rancière, "L'Inoubliable"
Quelle attitude adopter devant l’absence d’images, puisque les seules dont nous disposons sont celles de la libération des camps, images d’après le pire, de charniers, de fantômes, de survivants, enregistrant les traces de l’événement, mais échouant à rendre compte de la réalité de l’événement lui-même ? En acceptant de réaliser Nuit et brouillard à la demande du Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale, dans un film qu’il destine au public le plus large, Alain Resnais, aidé de son collaborateur Jean Cayrol, poète, essayiste et ancien déporté au camp d’Oranienburg, choisit d’affronter la question centrale du cinéma : celle de ses limites et de ses pouvoirs, de l’irreprésentable et de l’infilmable. Il y répond de la seule manière possible, en soumettant ses choix formels au préalable d’une réflexion sur l’éthique et sur la place qu’il entend réserver, en tant que cinéaste, à ses futurs spectateurs.
On compte 297 plans dans Nuit et brouillard : 269 sont en noir et blanc et 28 en couleur, ces derniers d’une durée moyenne de vingt secondes, pour quatre seulement aux précédents. L’alternance régulière des images en noir et blanc et des images en couleur correspond pour Alain Resnais à une définition active de la mémoire, envisagée tout au long de son œuvre comme ce qui fait toujours retour. Pour le cinéaste, la mémoire est ce mouvement, du bas vers le haut, par lequel remonte à la conscience ce que l’esprit avait enfoui. Telle apparaît ainsi la fonction de cette alternance : faire en sorte que les images exhumées, revenues des profondeurs, puissent sédimenter ; qu’elles ne disparaissent pas aussitôt apparues, emportées par l’émotion ; qu’elles ne « passent » pas, qu’elles nous travaillent, qu’elles nous parlent. Au noir et blanc, il consacre donc le traitement des documents d’archives, l’évocation des délires nazis, la description minutieuse et complète de l’implacable mécanique de mort mise en place par ceux-ci. À la couleur, il réserve les lents travellings méditatifs, filmés à Auschwitz par son équipe technique, sur les lieux mêmes de l’horreur, en 1955 : dispositif modeste, mais qui permet d’arrêter le flux des images, d’intercaler du temps entre les séquences, de les creuser, de les réfléchir au présent. En noir et blanc : le récit et l’Histoire. En couleur : la charge d’empêcher la plaie de se refermer et les images d’archives, toujours trop spectaculaires, de suturer ou de se boucler sur elles-mêmes en un ensemble trop lisse, trop confortable, trop cohérent.
En faisant tout le film en noir et blanc, je craignais d’obtenir avec ces vieilles pierres, les barbelés et un soleil de plomb, un romantisme qui n’aurait pas du tout été de bon aloi. — Alain Resnais à la revue "Premier plan", 1961
Manière de situer Nuit et brouillard du côté de la pensée, au plus loin possible du spectacle mis en scène et de l’empilement du visible.
Depuis le succès de La Liste de Schindler de Steven Spielberg, la représentation des camps est au centre d’un nombre de plus en plus important de fictions, au point d’apparaître comme un nouveau genre cinématographique à part entière, que l’on pourrait qualifier de « film-Auschwitz » ou fiction héroïque sur fond d’extermination. À chaque fois, il s’agit d’imager l’histoire d’un ou de plusieurs survivants (c’est-à-dire l’exception) dont nous suivons les épreuves et les humiliations contre la promesse d’un happy end, à grands coups de suspense et de dramatisation. Pour ces cinéastes, filmer le génocide a cessé d’être un problème spécifique et les questions qu’ils se posent sont celles qu’ils se posent pour tout film, thriller ou comédie de situation : comment faire exister un personnage ? Comment émouvoir ou faire rire ? Comment rendre crédible le scénario ? Comment exhiber sa mise en scène afin d’être perçu comme un auteur ou un artiste ? Face à tant de cynisme et de surenchère audiovisuelle, comment ne pas désirer revenir à la sobriété d’Alain Resnais, à la réduction des moyens comme il l’a pratiquée, à cette façon de s’en tenir aux gestes les plus simples du cinéma : un travelling latéral sans cesse répété, obsédant, lancinant, sans aucun effet sinon celui de garantir la transmission ? Face à l’exhibitionnisme obscène d’un Spielberg (caméra dans les chambres à gaz, caméra dans les wagons de la mort, les camps comme si vous y étiez, en simulation virtuelle comme dans un parc d’attractions : Auschwitzland après Jurassic Park), comment ne pas revenir buter sur les regards vides des déportés sans identité de Nuit et brouillard, sur ces visages dont nous sommes à peine capables de supporter la vision tant leur « infranchissable altérité nous maintient sur une autre scène » (Marc Vernet) ? « Arrêt sur le spectateur, arrêt sur l’image », là où le cinéma entre dans « son âge adulte. La sphère du visible a cessé d’être tout entière disponible : il y a des absences et des trous, des creux nécessaires et des pleins superflus, des images à jamais manquantes et des regards pour toujours défaillants. » (J. Rancière, op. cit)
On doit ainsi à Alain Resnais d’avoir rendu le cinéma possible après Auschwitz, à condition de considérer le cinéma pour ce qu’il est : un art de faire apparaître l’invisible, un art de faire voir au-delà.
Parce que l’art est toujours le présent d’une absence, parce qu’il est ainsi seul propre à rendre sensible l’inhumain. (...) [À cette condition,] la représentation peut alors retrouver son sens exact et premier (philosophique et artistique) : non pas une reproduction, elle-même soumise aux limites d’un « point de vue », mais un geste qui fait venir à la présence, une présentation. — Jean-Luc Nancy, « La représentation interdite », in "L’Art et la mémoire des camps", Le Seuil, 2001
Patrick Leboutte
chapitre de l'ouvrage Ces films qui nous regardent, éditions La Médiathèque, 2002