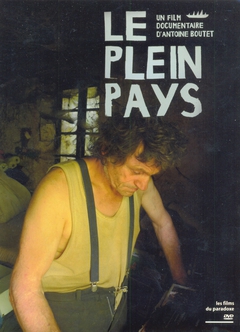« Le Plein pays » (Antoine Boutet) : le vent a dispersé voyelles et consonnes

Sommaire
Jean-Marie vit dans les bois, intégralement. Plus exactement, dans son monde à lui, coupé de la réalité. Entre travaux forestiers, archéologie fantaisiste, pulsions scripturales déclinées en gravures et sculptures sommaires, l’écoute des voix intérieures du destin et les rituels qui scandent son existence, l’exercice de la prophétie, l’apprentissage du poème sonore approximatif et le façonnage de son environnement en refuge souterrain contre l’Apocalypse, sa vie ressemble à un engagement mystique total. Perdu dans la forêt, ce n’est pas la communion avec la nature qui le préoccupe : il suffit d’entrevoir son dépotoir de vieux brols, vieilles machines, électroménager en rade, ordures, sacs en plastique, pneus et carcasses diverses, lambeaux de la société de consommation… C’est un marginal devenu un homme des bois par nécessité, un homme enfant, un artiste animal, un voyant tracassé.
Il est grand temps de trouver l’éternité ou de s’éteindre à fond, adopter ou s’éteindre à fond, abolir les maternités à fond, qu’on ne se reproduise plus, qu’on soit toujours les mêmes. — Jean-Marie Massou
Quand le verbe défait la chair
Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience : après six heures en solitaire à pédaler et à avaler du vent, ou au fond de votre jardin à semer, sarcler, arracher des mauvaises herbes durant une journée, lorsque vous vous adressez à la première personne civilisée rencontrée, en quittant le potager ou en descendant de selle, des sons inintelligibles s’échappent de votre bouche. Autre chose que des sons, en fait : de la matière. Le vent a dispersé voyelles et consonnes ou de la terre recouvre les sons et les lettres, à la place de phrases ordonnées, on crache un bout de paysage gobé dans une descente rapide, ou un fragment de lignes de carottes, en tout cas, il est impossible d’aligner quelques mots compréhensibles. La langue retrouve vite sa normalité, son volume et son agilité. Mais, si semblable situation d’isolement se prolonge des jours, des semaines, des mois ? Voire des années, pendant lesquelles l’usage du verbe se rétrécit, s’effrite et reste bloqué entre le dire et l’indicible parce que, enveloppé de silence, on dialogue mentalement et, je dirais, physiologiquement, en direct, sans en passer par une quelconque symbolisation, avec toutes les choses qui nous entourent et avec tous les absents, concrets ou imaginaires, qui comptent dans notre vie présente, passée ou future, en bien ou en mal ? Quand Jean-Marie se met à parler, je ne comprends rien à ce qu’il dit. Il parle une langue décantée, rocailleuse. Son verbe est une matière aérienne et organique, accidentée et poreuse, qui a pris l’empreinte de toutes les forces naturelles avec lesquelles il noue des relations viscérales, en constantes vibrations. Un flux verbal réifié qui a pris l’empreinte de ses viscères, ceux-ci ayant pris la forme des composantes végétales, pierreuses et terreuses de son décor et qu’il absorbe par tous les pores, dans lequel il se fond. Une langue hermétique, et pourtant elle chante, familière, on y reconnaît tout ce qui baigne le personnage : les arbres alignés, les roches, les cailloux, la terre, les outils, le tracteur, les sous-bois striés, les chemins, les taillis… Une langue décharnée, il n’en reste que les os et arêtes du souffle, aspérités et vides aspirants, les saillies et les creux, une poussière rude qui s’envole de la bouche de l’orateur maugréant – c’en est un, à sa façon –, en nuages, en cascades et éboulis, en déploiements, mobiles de sons fouillés, mangés entre eux et intempestifs. Cette manière sonore de s’exprimer épouse la plastique de ses gestes, mouvements et déplacements. Car tout semble réfléchi et ritualisé chez Jean-Marie. Quand il se promène, les signes que sa main trace sur chaque roche, les pressions et orientations du pied sur les pierres du chemin ou à l’entrée d’un terrier, les contorsions dansées du dos et du bras quand il parle à son peuple de cailloux, les passes et échanges avant de boire le café. Il n’est jamais au repos, il a toujours à faire. Quoi ? Rester en contact avec les ondes et vibrations de toutes les choses, les capter et les fixer dans son métabolisme, les transformer à son image, les faire siennes puis les disséminer, devenues ses vibrations intérieures vers les arbres, la terre, les roches, les racines, et ainsi, par aspiration et transpiration, transformer son paysage en espace matriciel sans fond, créer une atmosphère d’osmose avec le grand tout, une osmose parcourue par un amour-haine puissant pour la vie et sa conception, une peur terrible de l’enfantement.
Labyrinthe et cailloux qui vibrent
Après la première image où l’on voit l’homme disparaître dans son terrier, la caméra mesure le territoire en plusieurs travellings rectilignes, d’abord arrière, un plan à rebours qui donne l’impression de s’enfoncer loin de l’actualité du monde, sur l’air d’une mélopée vaguement celtique, répétitive, régressive. Puis travelling latéral, tiré au cordeau lui aussi, qui montre l’épaisseur des alignements de troncs et sous-bois, la lisière est loin, on est passé de l’autre côté de la surface des choses. Après ces quelques trajets en directions contradictoires qui tracent une géométrie labyrinthique – pour que l’on ne puisse constituer un chemin rationnel menant à Jean-Marie –, le réalisateur nous isole avec son personnage dans des cheminements beaucoup plus sinueux, tortueux. Des sentiers sans perspective, défoncés, des itinéraires connus par le seul Jean-Marie et fixés à force de passages instinctifs comme pour les sentes de sangliers, des vagabondages aléatoires – qui nous semblent tels, mais obéissent à la logique de recherches précises qu’il mène avec sa tige de métal –, entre les troncs et talus. Jusqu’à un plan fixe intrigant, qui va devenir un superbe tableau de passage secret illustrant comment le personnage fait communiquer différents mondes et plans du réel. Caméra sur des fourrés épais et hauts, garnis de grands genêts fleuris. Et puis Jean-Marie, dans son grand tracteur rouge, fonce dessus, plonge dans les buissons et arbustes, comme le bathyscaphe d’un plongeur dans les flots, disparaît, est comme avalé par les branchies végétales. On retrouve alors Jean-Marie en pleine exploration des fonds forestiers, creusant le sol à la houe, énergiquement, avec une belle technique aux gestes efficaces et harmonieux, exhumant une immense roche comme on le ferait d’une momie précieuse, corps enfoui d’une belle inconnue ayant régné sur les lieux, extraction et exhibition d’un objet précieux et étrange, charnel, produit par les entrailles de la Terre. Travaux de forçat pour l’arracher au sol, la hisser sur la remorque, la rapatrier près de la maison. Bataille et corps à corps. Là, dans les efforts physiques, la langue devient moins énigmatique, les interjections et jurons sont explicites ! Au moment de décharger la roche, de l’installer dans son nouveau lieu de séjour, il enclenche son petit lecteur de cassettes et diffuse une musique de film, style « retrouvailles » après de longues péripéties qui semblaient ne laisser aucun espoir, la bande-son tremblante pour des mondes disjoints enfin rapprochés. Après l’effort fulminant, la bataille acharnée pour l’extraction, c’est le calme, la détente, il caresse amoureusement sa nouvelle prise. Ce travail est clairement inscrit dans une démarche d’organisation, triage des éléments qui lui parlent : les belles grandes roches sont rassemblées en un seul lieu, un conservatoire, une communauté. Les gros cailloux blancs, qu’il va collecter dans un grand sac porté sur son dos, sont étalés dans une clairière. Il procède comme pour les « accumulations » en arts plastiques, mais proche aussi de l’esprit des « alignements ».
Les complaintes et la transe
Affairé, pressé, son visage concentré filmé de près, comme toujours agissant dans l’urgence, ce que l’on voit en fond – des troncs, des entrelacs de tiges, des écorces, des fibres, ronces, lianes, mousses, lichens, bois mort, feuilles séchées –, n’est plus vraiment perçu comme le décor extérieur, mais comme les matériaux fluides qui tapissent son paysage mental. C’est aussi forestier que marin, minéral qu’aqueux, une étendue travaillée, agitée, battue par les intempéries de l’éternité, par les marées de l’infini, c’est là-dedans qu’il se profile et c’est la partition que lui-même joue de toutes ses cellules. En tout cas, il y a une confusion entre l’intérieur et l’extérieur, vases communicants. Il est en train d’entendre Le Plat pays de Jacques Brel. Dans la séquence qui suit, debout dans sa cabane, il manipule son lecteur de cassettes et s’exerce à chanter la chanson Le Plein pays. Le chant est maladroit, faux, mais intense et senti, habité d’une détermination à faire corps avec les paroles et la musique. Quand il chante, il atteint une fusion entre le corps et l’esprit. La séparation de ces deux entités le tourmente profondément. Il prédit ou promet l’éternité, grâce à la science ou aux extra-terrestres, ce qui implique que le corps soit refait avec l’âme, tous deux réunis, devenus semblables, et que l’on reste ainsi à jamais, toujours les mêmes. Dans les complaintes qu’il élabore, récupérant des ritournelles enfantines, des ballades traditionnelles ou des tubes populaires, c’est un des thèmes récurrents qui découle de sa grande obsession : ne plus se reproduire, ne plus être soumis aux pulsions, aux sécrétions corporelles. « Il est grand temps de trouver l’éternité ou de s’éteindre à fond, adopter ou s’éteindre à fond, abolir les maternités à fond, qu’on ne se reproduise plus, qu’on soit toujours les mêmes. » L’obsession de la pureté le conduit à annoncer des temps où les « sucs gastriques et les besoins sentiront bon », où le sexe n’aurait plus aucun rôle à jouer. Il faudra alors migrer sur sa planète Sodorome, « une planète où les prostituées seront reçues, où elles seront changées de corps, sans sexe, sentiront bon, plus besoin de bouffer, de faire ses besoins… ». C’est une planète où le bonheur ressemble à celui de gosses dans un Noël permanent. Il compose de multiples « poèmes » qui chantent et décrivent cette future nouvelle vie, qu’il psalmodie pour éduquer le monde, en s’accompagnant de bouts de musiques repiquées artisanalement d’un poste de radio qu’il utilise pour fouiller les ondes. Il les entonne de mémoire, en marchant, ou mieux, au fond des incroyables galeries souterraines qu’il a creusées de ses mains, et il atteint alors la transe du prêtre. Dans ce dédale de tunnels qu’il a mis des années à réaliser (quarante ans), il semble dans son élément. Sur la roche, il a gravé quelques signes de son système de pensée, un espadon pour tuer les maternités, une lame Öphallique que l’on imagine conçue pour pénétrer le vagin et aller percer le fœtus (« attention, sans faire du mal aux enfants »), des croquis propitiatoires, des témoignages pour les générations futures, pour les futurs visiteurs du monde, après la catastrophe. Il nourrit une dévotion sans bornes pour Brigitte Bardot qui, malgré sa beauté, est restée sans enfants (« vierge »), à qui il dédie un autel, avec qui il chante et communie. Dans une moindre mesure, il admire Simone Veil pour tout son combat politique pour la contraception.
Conclusion
Jean-Marie n’est jamais montré comme un cas, rien n’est folklorisé, ce n’est pas du strip-tease. Il y a eu un vrai travail de rencontre entre lui et le réalisateur. C’est surtout évident en regardant le bonus Un an après. Il y a eu une sorte de contrat, comme entre un réalisateur et son comédien. Car Jean-Marie, devant la caméra, joue son rôle à la perfection. Il s’y incarne comme jamais.
Pierre Hemptinne
La Sélec, 2011